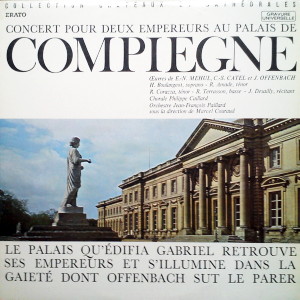 |
|
1 LP -
STU 70 323
|
|
| CONCERT POUR DEUX EMPEREURS AU
PALAIS DE - COMPIEGNE |
|
|
|
|
|
| LE PALAIS QU'ÉDIFIA GABRIEL
RETROUVE SES EMPEREURS ET S'ILLUMINE DANS
LA GAIETÉ DONT OFFENBACH SUT LE PARER |
|
|
|
|
|
|
Premier
Empire (NAPOLEON I)
|
|
|
| Etienne-Nicolas Mehul
(1763-1817) |
Les deux Aveugles
de Tolède (Overture) |
--' --" |
A1
|
| Charles-Simon Catel
(1773-1830) |
L'Auberge de
Bagnères (Introduction -
Air Basque) |
--' --" |
A2
|
|
Second
Empire (NAPOLEON III) |
|
|
| Jacques Offenbach
(1819-1880) |
Ba-ta-clan
(Chinoiserie musicale en un acte) |
--' --" |
A3
|
|
- 1.
Introduction et chœur · 2. Quatuor chinois
· 3. Romancé |
|
|
|
- 4.
Duo · 5. Ronde de Florette · 6. Duo
Italien · 7. Trio · 8. Le Ba-ta-clan et
Final |
--' --" |
B
|
|
|
|
| Huguette
Boulangeot, soprano (Fé-an-nich-ton) |
CHORALE PHILIPPE
CAILLARD |
|
| Raymond
Amade, ténor (Ké-ki-ka-ko) |
ORCHESTRE
JEAN-FRANÇOIS PAILLARD
|
|
| Rémy
Corazza, ténor (Fé-ni-han) |
Marcel Couraud,
Direction |
|
| René
Terrasson, basse (Ko-ko-ri-ko) |
|
|
| Jean
Desailly, récitant |
|
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
- |
|
|
Registrazione:
live / studio |
|
studio |
|
|
Producer /
Engineer |
|
Guy
Laporte
|
|
|
Edizione LP |
|
Erato
- STU 70 349 - (1 lp) - durata --'
--" - (p) 196? - Analogico |
|
|
Note |
|
-
|
|
|
|
|
Le
Palais de Compiègne
connut,
assurément,
ses heures le
plus brillantes
sous le
Second-Empire.
Napoléon
III y avait
entrepris de
nouveaux
aménagements
qu'il ne put
achever... pas
plus que ses
prédécesseurs
quim depuis
Louis XIII,
avaient fait
de ce Palais
un rendez-vous
de chasse et
un leiu de
séjour annexe
comme
Fontainebleau
ou
Saint-Cloud.
Sur le petit
théâtre,
une
représentation
d'opéra.comique
fut donnée à
l'intention de
Napoléon, lors
d'un de ses
courts arrêts
en compagnie
de
l'impératrice
Marie-Louise.
Des comédies
et revues y
furent jouées
sous le
Second-Empire:
l'une d'elle
eut pour
actrice
principale
l'Impératrice
Eugénie; une
autre eut pour
auteurs
Mérimée et le
Duc de Morny;
celui-ci avait
mis la main au
livret d'une
opérette
d'Offenbach,
le compositeur
adulé de la
nouvelle
société
impériale et
dont les
refrains
chantaient
dans toutes
les mémoires
comme les
valses de
Strauss que
débitait, à
Compiègne,
devant la
Cour... un
piano
mécanique!
Dés les
premières
années du XX
siècle, le
vieil
opéra-comique
connut un
regain de
faveur au
dépens du
drame. C'en
était fait des
sujets
lugubres,
terrifiants,
mélodramatiques,
bref de tout
ce qu'un
rédacteur de
"La Décade
Philosophique"
appelait "le
terrorisme
musical".
Bonaparte,
s'il réservait
ses faveurs
aux maitres
italiens,
n'était pas
insensible à
l'opéra-comique:
la romance du
Prisonnier
de
Della.Maria:
"Oui, c'en est
fait je me
marie..."
était un de
ses airs
favoris et sa
fanfare
préférée avait
pour thème un
choeur de La
Caravane du
Caire de
Grétry: "La
Victoire est à
nous...". A
Méhul, qui
venait de
faire jouer l'Irato
sous un
pseudonyme
italien, il
déclarait:
"Trompez-moi
encore souvent
de cette
manière!".
Méhul
(Givet, 1763 -
Paris, 1817)
fut, à coup
sûr, le plus
remarquable
compositeur
français de la
Révolution et
de l'Empire.
Un an avant la
création de Joseph,
il se
retournait
vers le genre
léger: le 28
janvier 1806,
il faisait
représenter à
l'Opéra-Comique
Les Deux
Aveugles de
Tolède. Si
les airs et
ensembles
n'ont ni
l'entrain, ni
la verve de
ceux de l'Irato,
en revanche,
l'ouverture se
révèle être
d'un intérêt
bien
supérieur.
Avec son
"boléro" - le
plus ancien, à
notre
connaissance
dans la
musique
symphonique
française -
ses
alternances de
majeur et
mineur de même
ton, elle se
relie à
l'ancienne
"musique
turque", mais
elle annonce
aussi Bizet.
Eléve de
Gossec et
premier
professeur
d'harmonie au
Conservatoire,
Charles-Simon
Catel
(Laigle, 1773
- Paris,
1830)
avait
brillamment
débuté pendant
la Révolution
par des hymnes
civiques et
èiéces
d'harmonie de
valeur. Après
le grand
opéra, il
aborde pour la
première fois
l'opéra-comique
avec L'Auberge
de Bagnères
créé le 23
avril 1807.
L'"Introduction"
l'emporte, non
seulement sur
les airs et
ensembles de
la partition
mais aussi sur
toutes les
ouvertures des
ouvrages
analogues.
Elle s'appule
sur un "air
basque"
rapporté par
le chanteur
Garat de sa
province
natale. Son
souvenir
planera au
terme de la Fantaisie
Concertante
pour piano et
harpe de L.-E.
Jadin et dans
le Boléro
final du
Premier
Concerto pour
harpe de
Bochsa le
fils.
Après avoir
végété pendant
cinq ans au
Théâtre
Français, Jacques
Offenbach
(Cologne, 1819
- Paris, 1880)
se dit que
"l'opéra-comique
n'était plus à
l'Opéra-Comique,
que la musique
véritablement
bouffe, gaie
et
spirituelle,
la musique qui
vit, enfin,
s'oubliait peu
à peu. Les
compositeurs
travaillant
pour
l'Opéra-Comique
faisaient,
ajoutait-il,
de "petit
grands
opéras". Je
vis qu'il y
avait quelque
chose à faire
pour les
jeunes
musiciens qui,
comme moi, se
morfondaient à
la porte du
théâtre
lyrique". Ce
"qualque chose
à faire",
c'était la
création d'un
théâtre dont
il fournirait
le répertoire
et assurerait
aussi la
direction; en
se heurtant au
départ à des
restrictions
non moins
tyranniques
que celles
imposées
naguère par
Lully (Pas
plus de trois
personnages,
pas plus d'un
acte!) mais
qu'importe...
le succès
viendrait
bientôt dans
cette nouvelle
société
impériale
avide de
s'étourdir
dans le faste
et les
divertissements
endiablés. Et
avec
l'impératrice
ennmie de la
"grande
musique",
l'opérette
avait devant
elle le plus
bel avenir. Il
allait
appartenir à
Offenbach
d'instituer
les
Bouffes-Parisiens
et d'y faire
triompher un
genre nouveau,
bien à lui et
auquel ses
émules
apporteraient
en général
plus de
finesse sans
se montrer
toujours
capables
d'autant de
brio.
Deux-jours
avant que ne
s'achève
l'année 1855,
marquée par la
première
Exposition
Universelle,
était créé
Ba-ta-clan:
c'était le
onzième
ouvrage
représenté sur
cette scène
depuis son
inauguration
au mois de
Juin et le
douzième
produit dans
la même année
par Offenbach!
La loufoquerie
de cette
"chinoiserie
musicale"
valait bien
celle de
l'"anthropophagie
musicale": Oyayaye
ou la Reine
des Iles
révélée au
mois de Juin.
Un succés
déòorant
accueillit ce
premier
plaidoyer en
faveur de la
joie, ce
premier
persiflage de
l'opéra
italien et du
mélodrame
romantique: Les
Huguenots
de Meyerbeer
s'y trouvant
parodiés dans
un incroyable
jargon
fanco-italo-chinois.
Les traits
dominants des
opérettes à
venir étaient
d'ores et déjà
parfaitement
dessinés grâce
à cette
première
collaboration
étroite
d'Offenbach et
de Ludovic
Halévy. C'est
dire toute
l'importance
de cer acte,
l'un des plus
réussis avec Pomme
d'Api et
qui devait
donner son nom
à un
café-concert.
Contrairement
à Saint-Saens
ou à Vincent
d'Indy qui
traitaient
l'opérette
avec mépris,
Ravel admirait
Offenbach: le
rapprochement
entre des
ensembles
syllabiques de
Ba-ta-clan et
certains
choeurs de
l'Enfant et
les Sortilèges
montrera que
cette
admiration,
comme toutes
celles de
Ravel, était
bien autre
chose qu'une
boutade!
Frédéric
Robert
|
|