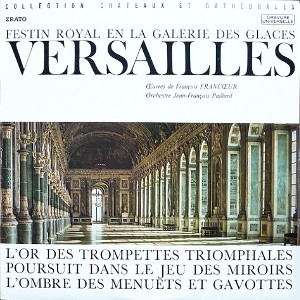 |
|
1 LP -
STU 70 316
|
|
| FESTIN ROYAL EN LA GALERIE DES
GLACES - VERSAILLES |
|
|
|
|
|
| L'OR DES TROMPETTES TRIOMPHALES
POURSUIT DANS LE JEU DES MIROIRS L'OMBRE
DES MENUÈTS ET GAVOTTES |
|
|
|
|
|
| François Francœur
(1698-1787) |
SYMPHONIES DU
FESTIN ROYAL DE MONSEIGNEUR LE
COMTE D'ARTOIS, année 1773 |
|
|
|
Quatrieme SUITE
mélée de trompette, timbales et
cors (extraits) |
20' 17" |
A1
|
|
- 1. Menuet I, de
F. REBEL - Menuet II, de F.
FRANCŒUR
|
|
|
|
- 2. Entrée de
chausseurs, de A. DAUVERGNE |
|
|
|
- 3. Menuet
gracieux, de J.-P- RAMEAU |
|
|
|
- 4. Air tendre,
de F. FRANCŒUR |
|
|
|
- 5. Air en
rondeau, de F. FRANCŒUR |
|
|
|
- 6. Musette, de
J.-J. de MONDONVILLE |
|
|
|
- 7. Rondeau, de J.-J. de
MONDONVILLE |
|
|
|
- 8. Rondeaux, de
F. FRANCŒUR |
|
|
|
- 9. Rondeau gay,
de F. FRANCŒUR |
|
|
|
Deuxieme SUITE
(intégrale) |
6' 52" |
A2
|
|
- 1. Ouverture, de
F. FRANCŒUR |
|
|
|
- 2. Air
majestueux, de J.-P- RAMEAU |
|
|
|
Deuxieme SUITE
(suite) |
24' 51" |
B
|
|
- 3. Contredanse,
de F. FRANCŒUR |
|
|
|
- 4. Air gracieux,
de F. FRANCŒUR |
|
|
|
- 5. Air vif, de F. FRANCŒUR |
|
|
|
- 6. Gavottes, de
F. FRANCŒUR |
|
|
|
- 7. Air très vif,
de A. DAUVERGNE |
|
|
|
- 8. Air marqué,
de F. FRANCŒUR |
|
|
|
- 9. Air en
chaconne, de B. de BURY |
|
|
|
- 10. Gavottes, de
J.-J. de
MONDONVILLE |
|
|
|
- 11. Air vif, de
F. FRANCŒUR |
|
|
|
- 12. Gavottes, de
J.-P- RAMEAU |
|
|
|
|
|
| ORCHESTRE
JEAN-FRANÇOIS PAILLAR |
|
| Jean-François
Paillard, Direction |
|
| (Restitution:
J.-F. Paillard) |
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
- |
|
|
Registrazione:
live / studio |
|
studio |
|
|
Producer /
Engineer |
|
Guy
Laporte
|
|
|
Edizione LP |
|
Erato
- STU 70 316 - (1 lp) - durata 52'
09" - (p) 1966 - Analogico |
|
|
Note |
|
-
|
|
|
|
|
De
Louis XIV à
Louis XVI,
tous les
évènements de
la Cour,
petits ou
grands, ont
été prétextes
à musique. Du
cérémonial
quotidien, la
messe à la
chapelle, les
soupers, les
couchers,
jusqu'aux
spectacles à
grand apparat,
carrousels,
fêtes,
réceptions
d'ambassadeurs,
les
compositeurs
du roi doicent
fournir sans
cesse des
accompagnements
appropriés qui
contribuent
largement à la
magnificence
royale.
Naturellement
les mariages
princiers ont
été l'occasion
de festivités
d'un éclat
particulier.
Rien que dans
les derniéres
années du
règne de Louis
XV, trois
mariages ont
été célébrés
en grande
pompe: celui
du Dauphon et
de
Marie-Antoinette
le 16 mai
1770, celui du
Comte de
Provence en
1771, celui du
Comte
d'Artois,
futur Charles
X, dernier roi
de France et
de Navarre,
avec
Marie-Thérèse
de Savoie, le
16 novembre
1773. Dans les
trois cas le
déroulement
est le même:
messe à la
chapelle,
réception dans
les
Appartements,
jeux à la
Galerie des
Glaces, à 10
heures 30
festin dans
l'opéra de
Gabriel,
inauguré en
1770, feu
d'artifice...
et les jours
suivants la
fête continue!
Le mariagé du
Comte d'Artois
fut maqué par
des
bousculades,
des désordres
que n'avaient
pas connus les
precédentes
cérémonies. En
outre un orage
gâia le feu
d'artifice,
dont le
responsable se
suicida! Mais
rien b'avait
été épargné
pour la
splendeur du
Festin. La
table royale
était décorée,
entre autres,
d'une rivière
qui coula
pensant tout
le banquet. Un
orchestre de
quatre-vingts
musiciens se
fit entendre.
François Rebel
le dirigeait
et son ami
François
Francoeur
avait fourni
la musique.
L'un et
l'autre
appartenaient
à des
dynasties
d'artistes et
ils sont
restés
associés, dans
une
collaboration
indéfectible,
tout au long
de leur
carriére.
Entre 1726 et
1773 on ne
trouve pas
moins de douze
oeuvres
lyriques
signées Rebel
et Francoeur.
Ce dernier
avait à
l'époque
soixante-quinze
ans. Il
s'était démis
de ses charges
de chef des 24
violons, de
compositeur de
la musique du
roi et de
directeur de
l'opéra. Mais
il restait un
important
personnage
officiel, qui
sera annobli
en 1764 et
recevra le
cordon de
saint-Michel
l'année
suivante. Son
Festin
Royal ne
comporte pas
moins de
quatre suites,
chacune de
plus d'une
demi-heure,
précédées de Fanfaren
qui ne sont
autres que la
Première
Suite de
Mouret. La
reliure de bau
manuscrit qui
nous conserve
cet important
ensemble porte
le titre
suivant: Concert
François
arrangé par M.
Francoeur
Surintendant
de la Musique
du Roy pour le
Festin Royal
de Mgr le
Comte d'Artois
années 1773.
Le terme
"arrangé"
correspond au
fait que
Francoeur a
fait de larges
emprunts à ses
contemporains,
emprunts qui
sont
d'ailleurs
indiqués d'une
manière
beaucoup plus
scrupuleuse
que ne le
comportalent
les moeurs
artistiques du
siècle. Au
demeurant la
majorité des
piéces vient
de lui. Parmi
les autres,
Rameau est
l'auteur de
trois
morceaux: un
Air majestueux
qui provient
des Fêtes
de l'Hymen et
de l'Amour
(2me
entrée,
sc. 4), deux Gavottes
de Dardanus
(Acte V,
derbière
scéne) et un Menuet
gracieux
avec les cors
de chasse,
dont nous
n'avons pu
déterminer la
provenance.
Quelques-unes
des plus jolie
pages son de
la plume de
Jean-Joseph
Cassanéa de
Mondonville
(1711.1772)
défenseur,
avec Titon
et l'Aurore
(1753), de la
musique
française dans
la "Querelle
des Bouffons",
introducteur
des sons
harmoniques
dans le jeu du
violon,
créateur de la
sonate
française
"avec clavecin
obligé",
compositeur
original et
gracieux qui
n'a pas encore
retrouvé la
place qu'il
méite. "Si je
n'étais pas
Rameau, disait
son
contemporain
Daquin,
qu'aurais-je
de mieux à
désirer que
d'être
Mondonville?"
Antoine
Dauvergne
(1713-1797)
est le
créateur de
l'opéra-comique
(Les
Troqueurs,
1753) et l'un
des principaux
artisans de la
symphonie
française.
Deux
compositeurs
figurent pour
une pièce; ce
sont des
collègues,
surintendants
de la musique
du roi: l'ami
Rebel et
Bernard de
Bury
(1720-1785)
qui, dès l'âge
de seize ans,
avait publié
un Livre
de pièces de
clavecin
où il ne
dissimule pas
son admiration
pour Rameau.
La
quatrième
suite, en
ré majeur, est
d'un style
beaucoup plus
éclatant, avec
ses
enluminures de
trompette et
ses fanfares
de cors de
chasse, que la
deuxième
suite, d'un
caractére plus
intime, plus
"musique de
chambre", à
l'execption
des deux
pièces (Contredanse
n° 2 et Air
très vif n°
7) où les
piccolos
introduisent
une note de
fantaisie
burlesque (il
y a dans la contredanse
des
"turqueries"
dopéra-comique).
En 1773 ke
styke gakant
s'est déjà
largement
imposé en
France et des
compositeurs
comme le
Chevalier de
Saint-Georges
publient des
oeuvres d'une
couleur
nettement
mozartienne.
Rien de cela
ne trasparait
dans le Festin
Royal. Il est
évidebt que la
cour reste
attachée à la
tradition des
Delalande, des
Mouret. Bien
des pièces de
Francoeur
pourraient
figurer, sans
détonner,
parmi les
suites des
Soupers du Roy
écrites un bon
demisiècle
plus tôt. Mais
ce
conservatisme
officiel n'est
pas un
"pompiérisme".
La tradition
demeure
vivante, la
musique coule
avec trop
d'aisance, de
naturel, de
charme, pour
ne pas être le
fruit de la
spontanéité.
Aussi cet
ensemble
reorPsente,
nous
semble-t-il,
un merveilleux
"échantillonnage"
de la vie
musicale à la
cour des Rois
Bourbon.
Au-delà de
leur très
grande, très
sédusante
valeur
artistique
intrinsèque,
ces pièces
dégageront, à
n'en pas
douter, un
puissant
parfum
évocateur pour
tous les
visiteurs et
admirateurs -
ils sont
légion - da
château d
Versailles.
Jean-François
Paillard
|
|