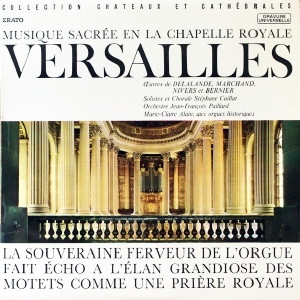 |
|
1 LP -
STU 70 315
|
|
| MUSIQUE SACRÉE EN LA CHAPELLE
ROYALE - VERSAILLES |
|
|
|
|
|
| LA SOUVERAINE FERVEUR DE L'ORGUE
FAIT ÉCHO A L'ÉLAN GRANDIOSE DES MOTETS
COMME UNE PRIÈRE ROYALE |
|
|
|
|
|
| Guillaume-Gabriel
Nivers (1632-1714) |
Suite du 2° ton |
--' --" |
A1
|
|
- Prélude
· Fugue · Dialogue de Rècits ·
Duo · Basse · Echo |
|
|
| Nicolas Bernier
(1664-1734) |
Motet du
Saint-Esprit pour soprano et
basse continue |
--' --" |
A2
|
| Louis Marchand
(1669-1732) |
Tierce en taille en ré mineur |
--' --" |
A3
|
|
Dialogue |
--' --" |
A4
|
| François Couperin le
Grand (1668-1733) |
PREMIER CONCERT
ROYAL pour dessus de viole et
basse continue |
--' --" |
A5
|
|
- 1.
Prélude · 2. Allemande · 3.
Sarabande · 4. Gavotte · 5.
Gigue · 6- Menuet en Trio |
|
|
| Michel-Richard
Delalande (1657-1726) |
Hymne
"Sacris Solemniis" Grand Motet pour
soli, chœur et orchestre /Révision et
réalisation: Laurence Boulay) |
--' --" |
B
|
|
- 1.
Chœur |
|
|
|
- 2.
Récit de basse (basson) |
|
|
|
- 3.
Petir chœur |
|
|
|
- 4.
Récit de ténor |
|
|
|
- 5.
Chœur |
|
|
|
- 6.
Récit de soprano (flûte)
|
|
|
|
- 7.
Récit de soprano et Chœur
|
|
|
|
|
|
Nivers, Bernier, Marchand,
Couperin le Grand
|
Delalande |
|
|
|
|
| Marie-Claire
Alain, aux grandes
orgues historiques de la Chapelle du Château
de Versailles |
Edith
Selig, soprano |
|
| Jocelyn
Chamonin, soprano |
André
Mallabrera,
ténor |
|
| Bernard
Fonteny, violoncelle |
Roger
Soyer, basse |
|
| Anne-Marie
Beckensteiner, clavecin |
Raymond
Guiot, flûte |
|
|
Paul
Hongne, basson |
|
|
Bernard Fonteny,
violoncelle |
|
|
Anne-Marie
Beckensteiner, clavecin
et orgue
|
|
|
CHORALE
STEPHANE CAILLAT
|
|
|
ORCHESTRE
JEAN-FRANÇOIS PAILLARD
|
|
|
Stéphane
Caillat, Direction |
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
- |
|
|
Registrazione:
live / studio |
|
studio |
|
|
Producer /
Engineer |
|
Guy
Laporte
|
|
|
Edizione LP |
|
Erato
- STU 70 315 - (1 lp) - durata --'
--" - (p) 196? - Analogico |
|
|
Note |
|
-
|
|
|
|
|
Grand
motet, petit
motet, pièce
d'prgue...
C'es trois
formes de
musique
religieuse
avaient place
sous les
voûtes de la
chapelle
royale, pour
accompagner ou
commenter les
offices
auxquels
assistaient le
Roi et sa
famille.
Michel-Richard
DELALANDE.
Surintendant
de la Musique
royale, est
célébre par
les grands
motets qu'il
composa sur
les textes des
psaumes. Si le
Sacris
solemnis
n'est pas la
traduction
musicale d'un
psaume, mais
d'une hymne au
Saint-Sacrement,
cette oeuvre,
datant de
1709, est
traitée en
style
concertant
comme tous les
grands motets:
qualques voix
solistes et un
choeur à cinq
voix sont
soutenus par
un orchestre
où les vents
s'ajoutent aux
vordes er au
continuo.
L'oeuvre est
scindée en
sept parties
où alterment
choeurs et
récits. Le
mouvement qui
seri
d'introduction
au motet est
une large
fresque
bi-partite.
Alors que òa
seconde partie
s'anime dans
un élan de
joie afin de
traduire de
plus pres le
texte, le
recueillement
préside au
départ de
l'oeuvre grâce
à
l'exploitation
du thème
grégorien à
l'orchestre
puls au choeur
fugué.
L'atmosphére
du motet tout
entier est ded
lors établie,
sous ses deux
éclairages:
gravité et
ferveur, force
et
enthousiasme.
Le récit
de basse
qui suit
suscite le
recueillement.
La voix
soliste est
accompagnée
par un double
counterpoint
de violons et
bassons
auxquels se
joint le
continuo:
"Nous
celebrons la
mémoire de la
dernière
Céne..." Pour
traduire le
trosième
verset,
Delalande
choisit un
petit choeur à
3 voix
accompagné par
les cordes;
cette page
précede un recit
de tènor
("Ils sont
faibles, et
pour les
réconforter.
Il leur
présente
l'aliment de
son corps")
qui ne termine
par les
paroles que
prononça le
Christi:
"Prenez cette
coupe que je
vous donne et
buvez-en
tous".
L'affirmation
de
l'institution
de ce
sacrifice est
confiée dans
le verset
suivant au
choeur
renforce par
l'orchestre.
Justement
celebre, le
Panis
angelicus
atteint
peut-être le
sommet de
l'oeuvre. La
flûte
traversière et
le soprano
échangent des
phrases d'une
admirable
sérénité,
insperées au
départ par le
thème
grégorien, et
de plus en
plus émouvant
lorsqu'elles
traduisent la
fin du verset
"manducat
Dominum
pauper, servus
et humilus".
C'est un
choeur
homophone,
pour clore ce
motet, qui
affirme sa foi
et sa
confiance dans
le Dieu unique
en trois
Personnes et
s'achiève en
un court mals
vibrant
"Amen".
Ce motet,
realisé
d'apres
l'edition
qu'en fit
Collin de
Blamont en
1729 ne
comportait une
instrumentation
détaillée que
dans les
récit. Elle
fut done
completée dans
les endroits
où elle
faisait défaut
et
principalement
dans les
choeurs et
interludes
symphoniques;
les parties
intermédiatres
(altos et
parfois même
seconds
violons)
furent
reconstituées.
Lorsque
Delalande se
démit en 1723
de trois des
quatre
quartiers qui
constitualent
sa charge de
sous-maitre à
la Chapelle
royale, il
confia ces
postes, avec
l'approbation
royale, à
Campra,
Gervais et
Bernier.
Nicolas
BERNIER, alors
âgé de
cinquante-neuf
ans, avait
derriére lui
une belle
carrière qui
l'avait
conduit -
aprés avoir
travaillé en
Italie avec
Caldara - à
Chartres (de
1694 à 1696),
à St-Germain
l'Auxerrois
puis à la
Sainte
Chapelle où il
avait succèdé
à Charpentier
(de 1704 à
1726). Ces
divers postes
de maitre de
chapelle
l'avaient
préparé à
recevoir la
charge de la
chapelle
royale qui
marqua le
couronnement
de sa
carriére. On
connait
surtout
Bernier comme
compositeur de
musique
profane par
les cantates
qu'il écrivit
à la demande
de la duchesse
du Maine, pour
les "Nuits de
Sceaux". Mais
son oeuvre
religieuse est
beacoup plus
importante, et
sa valeur est
réelle.
Quelques
grands motets
concertante à
la manière de
Delalande,
mais surtout
des petits
motets pour
une ou
plusieurs voix
solistes et un
effectif
instrumental
réduit,
témoignant
d'un art
délicat,
teinté parfois
d'italianisme.
Extrait d'un
recuil qui
parut en 1703,
ce petit Motet
du St Esprit,
confié à une
voix et basse
continue,
groups trois
parties. Un récitatif,
avec de
souples
vocalises
introduit un
air de facture
et d'esprit
italiens
auquel succéde
un joyeux alleluia
où une place
importante est
concédée à la
basse
continue,
laquelle
devance ou
commente les
interventions
vocales.
De tous les
organistes qui
brullerent à
la chapelle du
Roi Louis XIV,
Nivers et
Marchand -
l'un succédant
à l'autre -
furent parmi
les plus
grands.
Guillaume-Gabriel
NIVERS, né et
mort à Paris
(1632.1714)
fut-il éleve
de
Chambonnieres?
Apprit-il
auprés de Du
Mont la
composition?
Sa jeunesse
reste assez
obscure, et
l'on ne saura
it rien
affirmer quant
à ses années
de formation
musicale. On
le trouve
organiste à
St-Sulpice en
1654. Il fut
ensuite admis
comme chantre,
puis organiste
de la chapelle
royale (1678)
avant de
devenir maitre
de musique de
la Reine, puis
organiste et
mautre de
musique à
St-Cyr,
L'oeuvre que
nous laisse
cet artiste
d'une grande
pieté,
témoigne de sa
foi et de
l'influence
qu'il eut sur
l'evolution de
la musique
religieuse en
France.
Interprète et
théoricism,
Nivers ne
laisse rien au
basard et
règistre avec
beaucoup de
soin chacune
de ses pièces
d'orgue qui,
réunies soys
forme de
suites, sont
écrites dans
l'un des huit
tons de
l'Eglise. La Suite
du 2me ton
comprend sept
mouvements. Le
Prélude
fait alterner
le "positif"
et le "grand
plein jeu". A
ce prélude
fait suite une
Fugue à
3 voix, courte
piéce de style
imitatif, à
laquelle
succède un Récit
de caractère
plus
contemplatif.
Une phrase
ornée s'em
dégage,
soutenue par
un
accompagnement
harmonique sur
un "jeu doux",
lequel, dit
Nivers, "se
compose du
Bourdon et de
la Flutte, ou
du Bourdon et
du huit-pied".
Au duo,
également
bref, écrit en
contrepoint à
deux voix,
s'oppose une Basse,
c'est-à-dire
une page où la
partie
principale est
confiée a la
basse, alors
que la main
droite se
contente
d'accompagner.
L'Echo
est une forme
d'écriture
chère aux
Français
desireux
d'exploiter le
trosième
clavier ainsi
nommé de leur
instrument
dont
l'apparition
remonte au
premier tiers
du 17 siècle.
Ici encor, la
régistration
est indiquée,
et de courtes
phrases
passent du
"cornet" à l'
"écho" en un
va-et-vient
régulier
sostenu par
des accorde.
Le Dialogue
à deux choeurs
qui termine
cette suite
fait alterner,
comme dans le
prélude, le
"positif" et
le "grand jeu"
lequel se
compose, écrit
Nivers, "du
jeu de Therce
- il faut
entendre aussy
toute sa suite
- avec lequel
on met la
trompette, le
clarion, le
cromhorne, le
cornet, et le
tremblant à
cent s'il y en
a. Et le reste
à discrétion
dont le
mélange est
arbitraire."
Louis MARCHAND
appartien à
une autre
génèration. Ce
lyonnais, né
en 1669,
mourut à Paris
en 1732. Il
fut très jeune
organiste à la
cathedrale de
Nevers, puis à
celle
d'Auxerre,
avant
d'assumer à
paris la
responsabilité
de quatre
trubunes dont,
celle des
Jésuites de la
rue
St-Jacques.
C'est en 1706
qu'il succède
à Nivers à la
Chapelle
Royale. Mais
bientôt, sa
vie déréglée
l'oblige à
renoncer à ses
charges et à
quitter la
France. On
sait qu'il
alle en
Allemagne ey
qu'il fut mis
en compétition
avec J.-S.
Bach à Dresde
en 1717. Mais
il renonça au
dernier moment
à ce "tournoi"
qui, malgré la
grande
renommée de
virtuose sur
l'orgue ye le
clavecin qu'il
avait acquise,
eut peut-être
tourné à son
dèsavantage...
Rentré à
Paris, il ne
reprit que la
charge
d'organiste
des
Cordeliers. Si
l'un de ses
livres d'orgue
fut gravé
après sa mort,
les quatre
autres durent
attendre notre
siècle pour
avoir les
honneurs de la
publication. A
l'archaisme -
combien
poetique
parfois - de
Nivers,
Marchand
oppose une
écriture plus
souple, une
plus grande
carieté de
rhthmes, des
harmonies plus
riches. La Tierce
en taille
est une page
inspirée où,
comme son
titre
l'indique, le
chant est
situé à la
main gauche
qui chante en
"taille",
c'est-à-dire
entre la basse
et le
"dessus", sur
un jeu de
"tierce". Le Dialogue
sur le "grand
jeu" débute
gravement, sur
yne pédale de
tonique, puis
s'anime en un
trois temps où
la main gauche
se volt
indiquer un
"cromorne
positif"
tandis que les
deux parties
confiées à la
main droite
chantent sur
un "cornet de
récit". Après
des
alternances
entre le
"Grand jeu" et
l' "écho",
l'oeuvre se
termine par un
retour à
l'esprit du
début, grave
et homophone.
Nivers,
Delalande,
Marchand,
Bernier,
quatre noms
parmi ceux qui
illustrérent
la musique de
la Chapelle
Royale durant
quarante
années, et
dont les
oeuvres,
s'étageant de
l'aube au
déclin du
règne de Louis
XIV,
marquérent
l'évolution
d'une pensée
et d'un art
religieux en
France.
Laurence
BOULAY
|
|