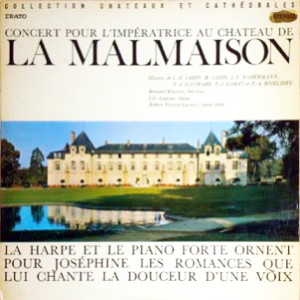 |
|
1 LP -
STE 50 307
|
|
| CONCERT POUR
L'IMPÉRATRICE AU CHATEAU DE - LA
MALMAISON |
|
|
|
|
|
| LA
HARPE ET LE PIANO FORTE ORNENT POUR
JOSÉPHINE LES ROMANCES QUE LUI CHANTE LA
DOUCER D'UNE VOIX |
|
|
|
|
|
| Louis-Emmanuel
Jadin (1768-1853) |
|
|
| Deuxième Duo
pour harpe et piano-forte en si
bémol majeur (Rondo) |
--' --" |
|
|
|
|
| Trois Romance
pour baryton et harpe |
|
|
| - Pierre-Jean
Garat (1764-1823): "Dans le printemps de mes
années" (Florian) |
--' --" |
|
| - Pierre-Jean
Garat (1764-1823): "Il était là!" (Comte de
Ségur) |
--' --" |
|
| - Martin-Pierre
D'Alvimare (1770-1838): "Mon cœur soupire" |
--' --" |
|
|
|
|
| Hyacinthe Jadin
(1769-1802) |
|
|
| Sonate
pour piano-forte en ut dièze mineur,
oeuvre IV n° 3 |
--' --" |
|
| -
Allegro moderato · Adagio · Rondo
allegretto |
|
|
|
|
|
| François-Joseph
Nadermann (vers 1775 - 1835) |
|
|
| Anglaise
rondoletto pour harpe, op. 92 |
--' --" |
|
Martin-Pierre
D'Alvimare
|
|
|
| Air russe varié pour harpe, op.
25 n° IV |
--' --" |
|
|
|
|
| Trois Romances pour baryton
et piano-forte |
|
|
- Hyacinthe Jadin: "Romance à la Lune"
|
--'
--" |
|
| - Louis-Emmanuel
Jadin: "La
Mort de Werther" |
--' --" |
|
| - Louis-Emmanuel
Jadin: "Chanson" |
--' --" |
|
|
|
|
| François-Adrien
Boieldieu (1775-1834) |
|
|
| Deuxième
Duo pour harpe et piano-forte
en si bémol majeur (Allegro
moderato) |
--' --" |
|
|
|
|
| Bernhard
Kruysen, baryton |
|
| Lily Laskine,
harpe |
|
| Robert Veyron-Lacroix,
piano-forte |
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
- |
|
|
Registrazione:
live / studio |
|
studio |
|
|
Producer /
Engineer |
|
Guy
Laporte
|
|
|
Edizione LP |
|
Erato
- STE 50 307 - (1 lp) - durata --'
--" - (p) 196? - Analogico |
|
|
Note |
|
-
|
|
|
|
|
En
1799,
Joséphine de
Beauharnais
achetait à La
Malmaison un
château
élevé sous
Louis XIII, et
dont le
dernier
propriétaire,
Lecouteux du
Moley, avait
fait depuis
1771 un des
lieux de
rencontre de
l'élite
parisienne.
Sur cette
ancienne
demeure, se
greffa
l'actuel
pavillon
dressé selon
les plans de
Percier et de
Fontaine. Pour
Bonaparte, La
Malmaison
devint un lieu
de travail, où
plusieurs
actes
historiques se
décidèrent.
Pour la future
Impératrice,
ce fut un lieu
de plaisir,
doté de
kiosques, de
Temples de
l'Amour, de
bergeries,
d'un salon de
musique relié
à une galerie
et à un petit
théatre qui
allaient tous
deux
disparaitre
sous la
Restauration.
Pensant
l'Empire,
Malmaison fut
de plus en
plus déclassé
pour
Saint-Cloud,
Compiegne ou
Fontainbleau.
Si bien qu'à
la
proclamation
du divorce,
Joséphine y
venait depuis
longtemps
presque seule.
Napoléon lui
rendit encore
visite; il lui
présenta même
l'heritier
qu'elle
n'avait pu lui
donner.
L'ex-impératrice
mourut en 1814
en cette même
Malmaison, peu
de temps après
y avoir reçu
le Tsar
Alexandre I.
Un an plus
tard,
Napoléon,
avant de
prendre le
chemin de
l'exil, y
évoquait, dans
une ultime
halte, le
souvenir de
cette "bonne
Joséphine" qui
avait fait,
pour un temps,
de Malmaison,
un nouveau
Trianon.
Les goûts bien
connus de
Bonaparte pour
les maîtres
italiens ou
italianisants,
comme le
piètre Della
Maria, n’ont
pas empêché
Joséphine
d’accueillir à
La Malmaison
des pianistes
et chanteurs
authentiquement
français,
applaudis en
d'autres lieux
par les
noiabilités
consulaires ou
impériales.
Leur musique
est un peu
semblable à la
peinture de
Prud’hon.
Empreinte des
graces
alanguies du
XVIII siècle
finissant, elle
se colore
d’accents
pathétiques,
héroïques ou
élégiaques,
annonciateurs
du romantisme,
et baignant
parfois dans
un
clair-obscur
opposé au
classicisme
froid et
déclamatoire
de David ou de
Cherubini. On
peut
aujourd’hui
encore admirer
dans le Salon
de Musique de
La Malmaison,
les
instruments de
l'Impératrice
l’épinette,
les deux
pianos-forte
et la harpe
qu’elle se
piqua de
pratiquer. Il
était bien
naturel, en
l’occurence,
qu’entre tous
les musiciens
qui firent les
délices des
soirées de La
Malmaison,
nous parlions
tout d’abord
du Maître de
Harpe de
Joséphine:
Martin-Pierre
d’Alvimare
(Dreux; 1770 -
Paris, 1838).
Ce dilettante
accéda aux
fonctions de
"Harpiste de
la Musique
Particuliére
du Premier
Consul",
devenu après
1804 "S. M.
l’Empereur et
Roi". I1 les
conserva
jusqu’en 1812;
rentré alors
en possession
de ses biens,
dont la
Revolution
l’avait
frustré, cet
aristocrate
normand se
retira de la
vie musicale;
à tel point
qu’il ne
voulut plus
entendre
parler, sous
aucun
prétexte, de
son passé de
harpiste et de
compositeur
"lequel
n’avait
pourtant rien
que
d’honorable"
(Fétis).
Certes,
d‘Alvimare
n’avait guére
eu de chance
avec son
unique ouvrage
lyrique Le
Mariage par
imprudence,
opéra-comique
un peu pâle,
dont on
déclara que la
seule
imprudence de
ses auteurs
était de
l’avoir fait
repréenter!
Mais, ni ses
romances, ni
ses
compositions
instrumentales,
toutes dédiées
à la harpe ne
méritaient
d’être reniées
par leur
auteur, encore
moins d’être
oubliées ou
dédaignées par
la postérité.
D’Alvimare
excellait
particulièremmt
dans le theme
varié,
s’appuyant sur
des motifs
originuux, des
romances ou
des airs
populaires
russes,selon
un usage qui
commençait à
se répandre en
occident, et
dont on
trouvera, à la
même époque,
des exemples
plus connus
chm Weber,
Hummel ou
Beethoven.
La plus
célébre des
romances de
D’Alvimare Mon
coeur soupire,
sur laquelle
l’auteur
lui-même
composa des
variations,
fut un des
triomphes de
Pierre-Jean
Garat
(Ustarritz,
1764 - Paris,
1823). Ce
chanteur de
charme, aux
manières
excentriques,
fut un des
interprètes
favoris de
Joséphine à
qui il rendit
encore visite
après 1809. La
fin de sa
carrière
publique
devait à peu
près coincider
avec la chute
de l’Empire.
Il est
impossible de
dénombrer les
pièces
chantées qui
lui valurent
tant
d‘applaudissements,
à commencer
par les
siennes
propres, parmi
lesquelles Dans
le printemps
de mes années
(1800) et Il
était là!
(1809), dont
la vogue s'est
maintenue
jusqu’à nos
jours.
Parues en
1796, les
trois romances
des frères
Jadin
sembleront
d'un style
beaucoup plus
pré-romantique.
Hyacinthe
Jadin
(Versailles,
1769 - Paris,
1802), etait
le deuxième
fils de Jean
Jadin, un
membre de la
Chapelle
Royale dont il
devait être
l’élève ainsi
que de
Hullmandell.
Durant sa
carrière,
hélas fort
courts, ce
premier
titulaire de
la classe de
piano-forte du
Conservatoire,
a peu écrit
pour la voix;
en dehors de
trois hymnes
civiques, on
lui doit cette
Romance a
la Lune où
se révèlent un
sentimmt
harmonique et
un sens des
proportions
peu fréquents
en France à la
fin du XVIII
siècle. On lea
retrouve plus
affirmés dans
son Ouverture
en Fa
(pour
harmonie) et
la plupart de
ses concerti
et sonates
pour le
pianoforte; de
ces dernières,
la plus
remarquable
est, sans
doute, celle
en ut dièze
mineur - ton
alors peu
usité - où se
profilent tour
à tour Weber,
Mendelssohn et
Beethoven.
Le frère ainé
de Hyacinthe
Jadin,
Louis-Emmanuel
(1768 - 1853),
qui lui devra
l'essentiel de
sa formation,
vécut. par
contre.
jusqu'à un âge
très avancé.
Il devait
mourir,
presqu'oublié,
à quatre-vingt
cinq ans, à
l‘aube du
Second Empire.
En 1830, il
s‘était retiré
près de
Montfort
l‘Amaury,
mettant fin à
une carrière
musicals
publique de
près de
quarante
années.
Claveciniste
au Théâtre de
Monsieur en
1790, membre
de la Garde
Nationale en
1792 (il
contribua avec
talent à
l'illustration
du Fêtes
Civiques), il
devait
succéder en
1802 à son
frère
Hyacinthe au
Conservatoire,
puis oecuper
les fonctions
de pianiste au
Théâtre
Molière en
1806 et enfin
de Gouverneur
des Pages de
la Musique du
Roi aux
Tuileries, de
1814 à 1830.
Louis-Emmanuel
Jadin passait
pour un den
plus brillants
pianistes et
accompagnateurs
de aa
génération. Sa
renomrmée
franchit même
les
frontières. La
Mort de
Werther
met en scéne,
un siècle
avant
Massenet, le
héros goethéen
en appelant à
son secours le
"plomb fatal".
A cette courte
scène
dramatique,
fait contraste
une délicieuse
Chanson en
forme de
rondeau,
profession de
foi romantique
jusqu’à la
caricature - Moi
j'aime la
maladie plus
encor que la
santé! -
et dont
certaines
modulations
font déjà
songer à La
Belle Meuniére.
Voilà qui
s'opposerait
aux
dénigrements
dont la
romance n'à
cessé d'être
victime dès
cette époque
où elle
atteignait sa
plus belle
floraison.
Louis-Emmanuel
Jadin consacra
au piano-forte
l‘esssentiel
d‘une
production
abondante
jusqu‘à la
prolixité et
dont une
grands partie
est restée
manuscrite. Il
exploita avec
autant
d'à-propos et
de
compréhension
les
pssibilités
expressives de
la harpe, la
combinant très
heureusement
avec le
piano-forte,
et même le
piano moderne
(Fantaisie
Concertante
pour harpe
piano et
orchestre,
v. 1820). De
ces deux duos
avec
piano-forte,
nous donnons
ici le final du
deuxième
"dédié à
Madame
Bonaparte".
Francois-Adrien
Boïeldieu
(Rouen 1775 -
Jarcy 1834)
fut présent
aux soirées de
La Malmaison
par quelques
unes de ses
romances que
fit applaudir
Garat.
Néanmoins, ses
premières
compositions
instrumentales,
toutes écrites
dans les cinq
dernières
années du
XVIII siècle
relèvent de la
même
esthétique que
celles de
Louis-Emmanuel
Jadin à qui,
d'ailleurs, le
musicien de La
Dame Blanche
sera toujours
reconnaissant
de l'avoir
encouragé à
ses débuts.
A son tour,
Boïeldieu
mélera les
cordes
frappées et
les cordes
pincéès dans
ses quatre
duos pour le
piano-forte et
la harpe. Le
plus
intéressant
est le
deuxième en si
bémol dont on
trouvera ici
seulement
l'Allegro
initial, très
supérieur à la
Pastorale
Variée qu'une
absence
complète de
modulations
rend monotone,
malgré
l'ingéniosité
renouvelée des
combinaisons
instrumentales.
Quant à
François-Joseph
Nadermann (v.
1773 - Paris
1835), fils du
luthier
Jean-Henri, le
facteur
ordinaire de
la Reine
Marie-Antoinette,
élève de
Krumpholz et
de Desvignes,
sa carrière
officielle
débuta
seulement en
1815 aux
Tuileries. De
1825 à 1835,
il allait, le
premier,
enseigner la
harpe au
Conservatoire.
Jusqu0au seuil
du romantisme
triomphant,
parallèlement
à Charles
Bochsa le
fils, le
successeur de
D'Alvimare, il
prolongea à la
harpe
l'esthétique
fin XVUUU
siècle. On en
trouvera un
excellent
témoignage
dans ce
Rondoletto à
l'anglaise,
écrit pour
exercer
l'élève à la
précision dans
l'usage des
pédales, et
extrait d'une
des sonatines
progressives
opus 92
insérées dans
sa Méthode.
Frédéric
Robert
|
|