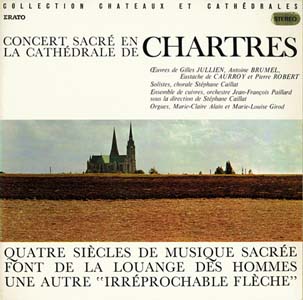 |
|
1 LP -
STE 50 248
|
|
| CONCERT SACRÉ EN LA CATHÉDRALE
DE - CHARTRES |
|
|
|
|
|
QUATRE SIÈCLE DE MUSIQUE SACRÉE
FONT DE LA LOUANGE DES HOMMES UNE AUTRE
"IRRÉPROCHABLE FLÈCHE"
|
|
|
|
|
|
| Gilles
Jullien (1650-1703) |
Prélude |
--' --" |
A1
|
| Antoine Brumel
(1460 - vers 1530) |
Motet
"Ecce panis angelorum" pour 4 voix
mixtes a cappella |
--' --" |
A2
|
|
Motet
"Mater Patris et Filia" pour 3
voix d'hommes a cappella |
--' --" |
A3
|
| Eustache du Caurroy
(1549-1609) |
Te
Deum (Restitution: Denise
Launay) |
--' --" |
A4
|
| Pierre Robert (vers
1618 - 1798) |
Grand
Motet "Nolite me considerare"
(Restitution: Héléne Charnassé -
Revision et réalisation: Laurence
Boulay) |
--' --" |
B1
|
| Gilles Jullien
(vers 1650 - 1703) |
Suite
du 7eme Ton |
--' --" |
B2
|
|
|
|
| Edith Selig, soprano |
ENSEMBLE DE CUIVRES |
|
| Gladys Felix, Nadine
Denize, altos |
ORCHESTRE DE
CHAMBRE JEAN-FRANÇOIS PAILLARD |
|
| André Meurant, tenor |
CHORALE STÉPHANE
CAILLAT |
|
| Louis Collet,
Georges Abdoun, barytons |
Stéphane Caillat,
Direction |
|
| Roger Soyer, basse |
|
|
| Pierre Pierlot, hautbois |
|
|
| Bernard Fonteny, violoncelle |
|
|
| Anne-Marie
Beckensteiner, orgue |
|
|
| Marie-Claire Alain,
aux grandes orgues historiques de
la Cathédrales d'Auch |
|
|
| Marie-Louise Girod,
à l'orgue Clicquot-Gonzales de
l'Eglise Saint-Merry de Paris |
|
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
Eglise
Saint Roch - gennaio 1965
|
|
|
Registrazione:
live / studio |
|
studio |
|
|
Producer /
Engineer |
|
Daniel
Madelaine |
|
|
Edizione LP |
|
Erato
- STE 50 237 - (1 lp) - durata --'
--" - (p) 196? - Analogico |
|
|
Note |
|
-
|
|
|
|
|
Des trois
soeurs gothique,
Chartres, Reims en
Amiens, la
première surtout
est un haut lieu
de l'esprit, de
l'art et de la
foi. Est-ce parce
qu'elle représent
l'art ogival dans sa plus
grande pureté?
Est-ce pour sa
nef audacieuse
élevée en peu
d'années
(1194-1225)? Ou
pour ce
foisonnement de
statues qui
peuplent ses
trois grands
porches de tous
les personages
de l'Ancien et
du Nouveau
Testament? Pour
l'éclat de ses
verrières du
XIII siècle qui
n'ont de rivales
que celles de
Bourges? Ou pour
ce
deux tours
dissemblables,
et pour sa
fiche "unique
au monde",
oeuvre de Jean
de Beauce?
Pour cela tout
ensemble, et
davantage
encore. L'un
des plus
frequentés
parmi les
leiux de
pélerinage,
Chartres a
reçu de
nombreuses
visites
royales,
peut-étre même
celle de saint
Louis.
Qui
ne connait
enfin cette
Présentation
de la Beauce à
N.D. de
Chartres,
hommage de
Péguy
converti?
"Tour de
David, voici
votre tour
beauceronne.
C'est l'épi
le plus dur
qui soit
jamais monté
Vers un ciel
de clémence et
de sérenité,
Et le plus
beau fleuron
dedans votre
couronne."
(La Tapisserie
de Notre-Dame)
L'école
de musique de
Chartres est
très ancienne.
Dès XI siècle,
l'évéque
Fulbert
favorise le
chant, compose
même, dit-on,
des hymnes. Au
XV siècle, la
maitrise est
érigée en
psalette.
Composée de 5
a 12 enfants
(selon les
époques) et de
24 adultes,
"heuriers",
elle assure un
service
musical très
chargè. A
l'occasion des
visites
royales, la
musique du Roi
prète aussi
son concours.
Parmi les
musiciens qui
ont occupé une
fonction à la
maitrise de
Chartres,
certains ont
laissé un nom,
soit par leur
science, soit
par leurs
compositions:
le flamand
Jean
Tinctoris,
l'un des plus
grands
théoriciens du
XV siècle, le
compositeur
Antoine
Brumel, son
contemporain;
aux XVII -
XVIII siècles,
Pierre Robert,
Nicolas
Bernier,
l'organiste
Gilles Jullien
dont
l'instrument
sera sans
doute bientôt
restauré...
Antoine
Brumel, qui
vient des
Flandres, n'a
guère que 23
ans, l'annèe
1483,
lorsqu'il
arrive à
Chartres.
Nommé
heurier-matinier,
il chante et
compose; mais
il quitte
bientôt
Chartres pour
Laon avant de
diriger la
maitrise de
N.D. de Paris.
Appelé enfin
par le duc de
Ferrare il
semble qu'il
ait préféré se
retirer à
Lyon. Son
renom de
compositeur
(Messes de 4 à
12 voix,
motets,
quelques
chansons
françaises)
ègalait
presque celui
d'Ockeghem, de
Tinctoris, de
Josquin,
d'Obrecht et
d'Isaac. La
date de sa
mort est
située vers
1520.
Deux motets de
Brumel on été
retenus, parmi
ceux qu'a
transcrits et
publiés Annie
Bank: Ecce
panis
angelorum,
extrait de la
séquence Lauda
Sion (de la
fête du
Saint-Sacrement)
est une pièce
à 4 voix dans
le style le
plus pur de la
deuxième école
neederlandaise.
Le Ténor
chante le
thème
liturgique
tandis que les
autre voix
dessinent un
counterpoint
en imitation
du chant
donné. La
dernière
partie, en
rythme
ternaire,
produit cet
effet de
carillon très
recherché par
les
compositeurs
de ce temps. Mater
matris et
filia,
motet à la
Vierge Marie,
est écrit pour
3 voix
d'hommes qui
chantent
tantôt en
style
d'imitation
fuguée, tantôt
en accords
verticaux. Le
"carillon"
traditionelle
amène une
conclusion
joyeuse,
On peut à bon
droit
s'étonner de
rencontrer ici
le nom
d'Eustache du
Caurroy,
sous-maitre de
la Chapelle
Royale,
compositeur de
la Chambre du
Roi. Né près
de Beauvais en
1549, mort à
Paris en 1609,
aucun lien ne
semble le
rattacher à
Chartres. Il
dût y paraitre
cependant, ne
serait-ce
qu'une fois
dans sa vie, à
l'occasion du
sacre du Roi
son maitre.
Henry IV en
effet ne fut
pas sacré à
Roeims,
conformement à
la tradition,
mais à
Chartres, le
27 février
1594. Il
n'avait abjuré
que 6 mois
auparavant, et
les ligueurs,
s'opposant à
son sacre,
occupaient
Reims
militairement.
On choisit
Chartres, mais
il fallut
aller quérir à
saint Martin
de Tours la
deuxième
sainte Ampoule
que les moines
vinrent
apporter
processionnellement.
a l'issue du
sacre et juste
avant la
Messe, le Te
Deum fut
chantè "en
musique par la
Chapelle du
Roy" (N. de
Thou, Cérémonies
observées au
sacre...
1594). L'usage
voulant que
les maitres de
chapelle
fissent
interpréter
leurs propres
oeuvres, ce Te
Deum ne
poivait être
que d'Eustache
du Caurroy.
La version
originale (in
Preces
ecclesiasticae,
Liber I,
1609) est
écrite pour 6
voix et
s'inspire du
thème
liturgique
sans le suivre
à la lettre.
Dans
l'interpretation
qui en est
donnée ici,
les cuivres
suppléent de
temps à autre
a certaines
voix du
choeur, ce
qu'autorisaient
parfaitement
les usage du
temps.
Les versets de
plain-chant
alternés avec
les choeurs
sont chantée
selon les
pricipes de
rythmique
accentyée
appliqués au
temps de la
Renaissance.
D.
Launay
Lorsqu'en
1650. Pierre
Robert
sollicite la
fonction de
Maitre de
Musique, ses
titres sont
bien faits
pour retenir
l'attention du
Chapitre de la
Cathédrale:
après de
solides études
à la Maitriae
de Notre-Dame
de Paris, le
jeune prêtre y
a été nommé
"surveillant
des enfants",
une de ses
oeuvres vient,
en outre,
dètre
couronnée au
Puys de
musique de
Mans.
Il n'est pas
douteux qu'une
carrière aussi
solidment
fondée ait
tenu ses
promesses:
dix-huit mois
après son
arrivée, le
musicien
quitte
Chartres. La
cathédrale de
Senlis et, de
nouveau,
Notre-Dame
marquent les
étapes d'une
rapide
acension qui
s'achève à la
Chapelle
Royale, où
Pierre Robert
obtient
successivement
les charges de
sous-maitre,
puis de
compositeur. A
cette époque,
le grand motet
pour solistes,
choeur et
orchestre
s'introduit à
l'église.
Pierre Robert
y souscrit
volontiers
ainsi qu'en
témoigne un
important
recueil
publié, à la
fin de sa
carriére
officielle
"par expres
commanderment
de sa
majesté."
Le motet Nolite
me considerare,
écrit sur un
texte extrait
du Cantique
des Cantiques,
et destiné à
la splennité
de Notre-Dame
des Sept
Douleurs, est
emprunté à cet
ouvrage.
Si l'orchestre
y apparait
conformément à
l'usage du
temps,
l'ensemble
vocale
comprend,
outre le
choeur, sept
solistes qui
interviennent
dans des
"récits" à une
ou plusieurs
voix, conçus
avec une
extréme
liberté. Art
de transition,
d'un
italianisme
assagi, qui
nous éclaire
bien sur la
position d'un
ecclésiastique
face au grand
motet
versaillais.
Cette
solennité des
offices est
également
obtenue, à
Chartres,
grâce à la
présence
d'excellents
organistes.
C'est ainsi
qu'à la fin de
1667, le
chapitre
s'assure le
concours de
Gilles
Jullien,
probablement
élève de
Nicolas
Gigault.
L'orgue de la
cathédrale,
considéré
comme "l'un
des plus beaux
du royaume", à
étè
reconstruit au
siècle
Précédent par
Robert
Filleul, et
pourvu, peu de
temps après
Saint Merry
(1647), d'un
troisiéme
clavier dir
"d'écho". Ses
jeux de
cornets, de
flûte,
cromornes ou
voix humaine,
sont de la
plus haute
qualité.
A la suite de
ses maitres
spirituels, la
même année que
François
Couperin
(1690), Gilles
Jullien publie
un Premier
livre d'orgue
qui comprend
quatre vingt
pièces
groupées selon
les tons de
l'église et un
Motet de Sainte
Cécile. La
"Suite du VII
ton" reflète
bien les
différents
aspects de cet
art: écriture
audacieuse du
Prélude émailé
de
dissonances,
raffinement
des Duos,
invention
mélodique des
rècits,
grandeur enfin
du Dialogue
conclusif.
Tout les
acquisitions
des maitres de
la génération
précédente
sont présentes
ici; l'abandon
du
plain-chant,
certains
caractéres du
style tour à
tour brillant
et dramatique,
permettent
néanmoins
d'entrevoir
l'esthétique
de concert
vers laquelle
glissera
bientôt
l'école
d'orgue
française du
18eme siècle.
H.
Charnasse
|
|