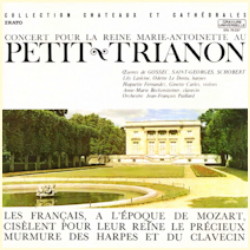 |
|
1 LP -
STE 50 237
|
|
| CONCERT POUR LA
REINE MARIE-ANTOINETTE AU - PETIT
TRIANON |
|
|
|
|
|
LE FRANÇAISE A L'ÉPOQUE DE MOZART
CISÈLENT POUR LEUR REINE LE PRÉCIEUX
MURMURE DES HARPES ET DU CLAVECIN
|
|
|
|
|
|
| François-Joseph
Gossec (1734-1829) |
Symphonie
Concertante du ballet de Mirza
pour 2 harpes et orchestre |
--' --" |
A1 |
|
-
Allegro · Largo · Rondeau |
|
|
| Joseph Chevalier de
Saint-Georges (1739-1799) |
Symphonie
Concertante en sol majeur pour 2
violons et orchestre |
--' --" |
A2 |
|
-
Allegro · Rondeau |
|
|
| Johann Schobert
(1740-1767) |
4°
Concerto pour le clavecin en ut
majeur op. XV |
--' --" |
B |
|
-
Allegro assai · Adagio · Allegro
assai |
|
|
|
|
|
| Lilly Laskin, Odette Le
Dentu, harpes |
ORCHESTRE
DE CHAMBRE JEAN-FRANÇOIS
PAILLAR |
|
| Huguette
Fernandez, Ginette Carles,
Violons |
Jean-François Paillard,
Direction |
|
| Anne-Marie
Beckensteiner, clavecin |
|
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
novembre
1964
|
|
|
Registrazione:
live / studio |
|
studio |
|
|
Producer /
Engineer |
|
Daniel
Madelaine |
|
|
Edizione LP |
|
Erato
- STE 50 237 - (1 lp) - durata --'
--" - (p) 196? - Analogico |
|
|
Note |
|
-
|
|
|
|
|
"Ces
lieux ont toujours été
le sèjour des
favorites des Rois, ce
doit être le vôtre",
dir Louis XVI à
Marie-Antoninette en
lui remettani le
domaine de Trianon.
C'est pour Madame de
Pompadour en effet que
Louis XV fu ètablir en
1749, à l'extrémité du
Grand Trianon (où
Louis XIV, déjà,
logeat Madame de
Maintenon), une petite
ménagerie paysanne
ornée bientôt d'un
"Pavillon Français".
De 1762 à 1768
Jacques-Ange Gabriel
construistt et décora
un de ses
chefs-d'oeuvre: le
Petit Trianon. Les
lignes calmes des
bolseries sculptées
par Guibert marquent
òìabandon définitif de
la rocaille et le
triomphe du
néoclassicisme. Ce
bâtiment, qui est un
des premiers
témoignages du "retour
à l'antique", reflète
l'élàgance dépouilée
de l'architecture
civile du XVIII
siècle. Madame du
Barry y succédera à la
Pompadour jusqu'à la
mort de Louis XV, en
1774.
Louis XVI, devenu roi,
donna les deux
Trianons à
Marie-Antoinette, mais
le Petit Trianon fut
la retraite
provilegiée de la
Reine qui, lasse des
conversations de la
cour, trouvait la
l'isolement favorable
à une vie de société
intime partagée entre
la conversation, le
jeu, le théâtre et la
musique. Le jardin
"anglo-chinois", la
gracieuse petite Salle
de comédie, la
trasformation du
Pavillon Français en
salon de conversation
et de musique, la
création du Hameau
paysan rappellent le
climat de bergeries
galantes, cette union
de raffinement et de
rustichè champètre
qui, par djà les
années, semble tendre
la main à l'Astrée
d'Honoré d'Urfè, comme
pour servir
d'encadrement précieux
à deux siècles
d'apogée de la
monarchie et aussi de
la culture française.
La musique de ce temps
évoque à merveille ce
climat de grâce, de
charme d'une société
un peu frivole
peut-être mais si
séduisante! D'ailleurs
les pressentiments des
troubles à venir,
comme les premières
palpitations d'un
préromantisme encore
inconscient, viennent
parfois agiter cette
surgace limpide et
reposante en lui
conférant une nouvelle
profondeur. On s'en
apercevra notamment
dans l'adagio du
Concerto de Schobert.
François-Joseph Gossec
(Vergnies, Hainaut, 17
janvier 1734 - Passy,
16 février 1829), par
son importante
production
symphonique, qui
s'étend sur plus d'un
demi-siècle, a joué,
pour la France, un
rôle de chef d'école
comparable à celui de
J. Haydn pour les pays
germaniques. sa
Symphonie concertante
en ré a été ajoutée au
ballet en trois actes
Mirza (1779).
Il en existe plusieurs
versions. L'une,
manuscrite est pour
flûte, violon, harpe
et orchestre. Une
autre, publiée par
Bailleux en 1784 est
pour "violon, flûte et
altos concertans". La
trisième, que nuos
avons adoptée, est
èpur deux harpes et
orchestre; le
manuscrit autographe
du Conservatoire
garantit son
authenticité. Ses
thémes allègros,
pimpants, justified
l'opinion du Mercure
(juillet 1784): "On se
rappelle que cette
symphonie est une de
celles de l'Auteur qui
a fait le plus
plaisir, et c'est
beaucoup dire...".
La symphonie
concertante est
d'ailleurs un genre
spécifiquement
français, dont Mozart
ne manque pas de faire
son profit en 1778.
Les statistiques
établies récemment par
Mr Barry S. Brook
montrent que les
compositeurs français
ont écrit à eux seuls,
dans la seconde moitié
du XVIII siècle, plus
du double de
symphonies
concertantes que tout
le reste de l'Europe!
Parmi eux, Joseph
Boulongne, chavalier
de Saint-Georges, né
vers 1739 à la
Guadeloupe et mort à
Paris en 1799, a
cultivé ce genre avec
une aisance
particulière. Ce
brillant mulâtre est
une des figures les
plus curieuses et les
plus attachantes de la
fin du XVIII siècle et
ses multiples
aventures ont suffi à
alimenter un roman en
4 volumes de R. de
Beauvoir (1840).
Violiniste au "talent
moelleux", il a abordé
tous les genres prisés
à l'époque: sonate,
symphonies, concerto,
romance, comédie à
ariettes.
La Symphonie
concertante en sol
majeur op. XIII
(1782), composée pour
un effectif restreint,
"deux violons
pricipalles" (sic) et
orchestre à cordes,
est dessinée avec la
légèreté de touche
d'un pastel, la
finesse de trait d'une
eau-forte. La
spontanéité et le
charme mélodique en
font une des pages les
plus gracieuses et les
plus souriantes de
toute la musique
française. (C'est par
erreur que notre
enregistrement
précédent de la même
oeuvre portait "oeuvre
IX, n° 2, 1778").
Le silésien Johann
Schobert, mort à Paris
en août 1767,
empolsonné par des
champignons cueillis
en forêt de
Saint-Germain, a été
adopté par la France à
un point tel qu'un
auteur aussi nettement
ermanique que Riemann
le traite de "maitre
français". Wyzewa et
Saint-Fox nous
apprennent qu' "en
fait, depuis 1763
jusqu'au
bouleversement général
de la Révolution, il a
été le plus joué et le
plus aimé des auteurs
de sonates
françaises". Ses
compositions on été
publiées au moment où
le piano-forte faisait
son apparition;
cependant le mot
clavecin est seul à
figurer en ses titres
et Grimm nous parle de
lui comme d'un claveciniste
qui a "ruinè de fond
en comble la
réputation des
Couperin, des du Phly,
des Balbastre..." Bien
qu'il ne soit pas
absurde d'interpréter
ses oeuvres au piano,
il semble préférable
de les confier au
clavecin.
Le Quatrième
concerto pour le
clavecin, op. XV,
en ut majeur, a du
ètre publié aux
environs de 1766. Les
deux allegro assai,
écrits dans une
atmosphère joyeuse,
limpide, sont embuès à
certains moments par
des plongées soudaines
dans le mode moneur et
des modulations
mystérieuses.Les rêves
ainsi éveillés
prennent leur essor
dans l'adagio,
une grande page
mèditative, chargée
d'émotion et qui
s'évade très loin des
poncifs, du style
galant. On doit
reconnaitre ici, avec
Wyzewa et Saint-Foix,
que "la preniére de
ces keçons
impérissables que
Mozart a prises dans
l'oeuvre de Schobert a
été de découvrir que
l'art musical était en
état de remplir une
fonction poétique" et
qye "Mozart a dû à
Schobert la conscience
salutaire de son génie
de poète. "Est-il plus
bel éloge de notre
musicien?
Jean-François
Paillard
|
|