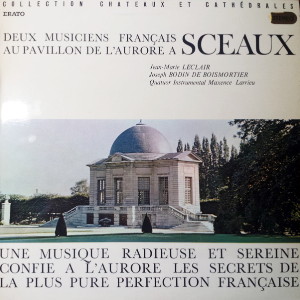 |
|
1 LP -
STE 50 211
|
|
| DEUX MUSICIENS
FRANÇAIS AU PAVILLON DE L'AURORE A -
SCEAUX |
|
|
|
|
|
| UNE MUSIQUE RADIEUSE ET SEREINE
CONFIE A L'AURORE LES SECRETS DE LA PLUS
PURE PERFECTION FRANÇAISE |
|
|
|
|
|
| Joseph
Bodin de Boismortier
(1687-1755) |
Concerto
IV op. 21 pour flûte, hautbois,
violoncelle et clavecin |
--' --" |
A1 |
|
-
Allegro · Adagio · Allegro |
|
|
|
Sonate
en mi mineur op. 37 No. 2 pour
hautbois, violoncelle et clavecin |
--' --"
|
A2 |
|
-
Allegro · Adagio · Allegro |
|
|
|
Sonate
en sol mineur op. 34 No. 1 pour
flûte, hautbois, violoncelle et
clavecin |
--' --" |
A3 |
|
-
Allegro · Presto · Adagio |
|
|
| Jean-Marie Leclair
(1697-1764) |
Sonate
en re mineur pour flûte, hautbois,
violoncelle et clavecin |
--' --" |
B1 |
|
-
Adagio · Allegro · Aria · Sarabande
· Allegro |
|
|
|
Sonate en re
majeur pour flûte, violoncelle
et clavecin |
--' --" |
B2 |
|
-
Adagio · Allegro · Sarabande ·
Allegro assai |
|
|
|
|
|
| QUATUOR INSTRUMENTAL
MAXENCE LARRIEU |
|
|
| - Maxence Larrieu, flûte |
|
|
| - Jacques Chambon, hautbois |
|
|
| - Bernard Fonteny, violoncelle |
|
|
| - Anne-Marie
Beckensteiner, clavecin |
|
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
marzo
1964
|
|
|
Registrazione:
live / studio |
|
studio |
|
|
Producer /
Engineer |
|
Daniel
Madelaine |
|
|
Edizione LP |
|
Erato
- STE 50 211 - (1 lp) - durata --'
--" - (p) 196? - Analogico |
|
|
Note |
|
-
|
|
|
|
|
Le
domaine de Sceaux
apparait dans
l'histoire en 1440,
lorsq'un décret en
adjuge la Seigneurie à
Maître Jean Paillard,
conseiller au
Parlament de Paris.
Mais ce n'est que
beacoup plus tard
qu0il accède à la
notoriété, lorsque
Colbert l'acquiert en
1670.
Perrault dresse les
plans du nouveau
château, Le Nôtre
dessine le parc que
Tuby, Girardon, Puget,
Coysevox ornent de
statues tandis que
d'immenses travaux
font jaillir l'eau des
fontaines. Le fils de
Colbert, Jean-Baptiste
de Seignelay, creuse
le Grand canal à
partir de 1685, fait
construire par
Hardouin-Mansart
l'actuelle Orangerie,
remanie le parc. La
visite de Louis XIV et
de sa suite, le 16
juillet 1685, marque
l'apogée de son règne.
En 1699 le domaine
devient la propriété
du duc du Maine - fils
ainé de Louis XIV et
de Madame de Montespan
-, et de la duchesse,
- Louise Bénédicte de
Bourbon-Condé, petite
fille du vainqueur de
Rocroi. La duchesse
s'entoure d'une
brillante cour
littéraire. En
contrast avec
l'atmosphère austère
de Versailles durant
les dernières snnées
du Roi-Soleil, la cour
de Sceaux s'adonne à
d'innombrables
divertissements dont
les organisateurs
infatigables sont
l'académicien Nicolas
de Malézieu et la
secrétaire de la
duchesse, Mademoiselle
de Launay.
Les fastes atteignent
un point culminant en
1714 et 1715 avec les
Grandes Nuits de
Sceaux,
ordonnées tous les
quinze jours par un
seigneur et une dame,
sacrés pour la
circonstance "Roy et
Reine de la Nuit." La
mort de Louis XIV,
puis une conspiration
qui oblige le duc à
s'exiler qualques
années, interrompent
cette vie brillante,
mais pour un temps
seulement. Tout n'est
pas fini avec les
Nuites de Sceaux et à
partir de 1722 la cour
sereforme. Voltaire,
inquiété par la police
royale, y trouve un
refuge pour écrire Zadig.
Jusqu'à la mort de la
duchesse duMaine
(1752) la vie
artistique française
est représentée en ces
lieux.
Malgré les saccages de
l'époque
révolutionnaire, il
nous reste des
témoignages
authentiques des
splendeurs passées, et
notamment le Pavillon
de l'Aurore, un
des monuments les plus
séduisants du XVII
siècle, restauré avec
goût de 1956 à 1958.
La rotonde centrale
est surmontée d'une
coupole décorée par Le
Brun: L'Aurore, image
de Colbert annonçant
la venue du
Roi-Soleil. Les deux
ailes carrées sont
ornées de plafonds de
Delobel, commandés en
1751 par la duchesse
du Maine qui s'y
trouve représentée
sous les traits de
Flore et de Pomone.
Les modernes Nuits
de Sceaux lui
ont redonné vie en y
accueillant de
nombreux concerts de
musique de chambre.
Boismortier et Leclair
occupent, à des titres
divers, un place de
choix dans la musique
de chambre française,
contemporaine de la
duchesse du Maine.
Joseph Bodin de
Boismortier "bourgeois
de Paris", est mort le
28 octobre 1755 en sa
propriété de la
Gastinellerie à
Roissy-en-Brie, "âgé
de soixante huit ans
environs". Plus de
cent numèros
d'oeuvres, chaque
numéro correspondant
le plus couvent à six
compositions et, par
trois fois, à un
opéra, représentent un
bagage de qualques
cinq cents concertos,
sonates, suites,
cantates, motets...
Une telle fécondité,
assez courante
outre-monts n'est pas
ordinaire chez un
compatriote de
Couperin, et si toutes
les pages n'atteignent
pas au sublime, La
Borde avait déjà
remarqué que "qui
voudrait se donner la
peine de fouiller
cette mine abandonnée,
pourrait y trouver
assez de paillettes
pour former un
lingot."
Mélodiste aisé, solide
harmoniste, habile et
curieux utilisateur
des timbres
instrumentaux,
Boismortier prodigue
sans effort une
musique de grande
qualité. Les
"paillettes" réunies
par le Quatuor M.
Larrieu brillent de
l'or le plus pur.
Le Concerto IV
en si mineur est
extrait du "Vingt et
unième oeuvre
contenant six concerto
(sic) pour les flûtes,
violons ou hautbois
avec la basse, Paris
1728." Il s'agit de
compositions qui
peuvent se jouer à
volonté avec ou sans
orchestre, pratique
qui se poursuivra très
avant le XVIII siècle.
Même dans la version
en quatuor le "faciès"
de concerto grosso
reste très accusé,
avec les unissons
caractéristiques, les
"tutti" groupés et les
"soli" dans ledquels
chaque instrument
prend la parole à son
tour.
La Sonate en mi
mineur Op. 37
pour hautbois,
violoncelle et
clavecin est la
seconde d'un recueil
"contenant 5 sonates
en trio pour un dessus
et 2 basses, suivies
d'un concerto à cinq
parties... Paris
1732." Ici, et a la
différence de la
plupart des sonates du
temps, le clavecin ne
double pas le
violoncelle, qui est
doté d'une partie
indépendante,
préfigurant le
dispositif du trio
classique.
La Sonate en sol
mineur Op. 34 n° 1
appartient à un groupe
de "six sonates à
quatre parties
différentes et
également travaillées
pour 3 flûtes, violons
ou autres instruments
avec la basse. Paris
1731". Lesqualités de
contrapuntiste de
Boismortier s'y
manifestent avec
éclat.
Sì l'oeuvre de
Jean-Marie Leclair
(1697-1764) est
beacoup moins
importante,
numériquement parlant,
elle est d'une autre
classe. On peut le
dire sans rien enlever
au charme si spontaném
si attachant de
Boismortier; Leclair,
chef de file
incontesté de l'école
française du violon,
est de même stature
que Couperin et
Rameau. Les critiques
les plus avisés ont
comparé son rôle en
France à celui de
Corelli et de Bach
outre-monts et
outre-Rhin.
La Sonate en ré
mineur, Op. IV n° 3,
publiée aux environs
de 1730, pousse trés
loin les recherches
harmoniques et
contrapuntiques. M.
Pincherle a rapproché
le Grave initial de la
fugue pour orgue en la
mineur de Bach (BG XV,
p 189). La perfection
de la fugue à deux
sujects, qui lui
succède, est belle que
le célèbre théoricien
allemand Marpurg l'a
reproduite
intègralement dans son
Traité de la Fugue
et du Contrepoint
(1756), ouvrage où il
place Leclair au même
rang que Haendel,
Telemann et les Bach.
Après la Sarabande aux
harmonies audacieuses,
l'Allegro final fait
preuve d'un entrain
étourdissant.
La Sonate en ré
majeur pour flûte,
violoncelle et
clavecin est la
huitième du "second
livre de sonates pour
le violon et pour la
flûte traversière avec
la basse continue"
publié vers 1728. Ici,
comme Boismortier dans
la sonate de l'opus
37, Leclair écrit un
vrai trio, avec une
partie de cioloncelle
qui, loin de doubler
le clavecin, dialogue
avec la flûte a
égalité, non seulement
thématique, mais même
de virtuosité.
Jean-François
Paillard
|
|