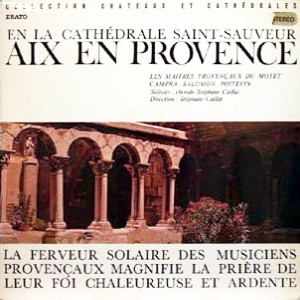 |
|
1 LP -
STE 50 186
|
|
| EN LA CATHÉDRALE
SAINT-SAVEUR - AIX EN PROVENCE |
|
|
|
|
|
LA FERVEUR SOLAIRE DES MUSICIENS
PROVENÇAUX MAGNIFIE LA PRIÈRE DE LEUR FOI
CHALEUREUSE ET ARDENTE
|
|
|
|
|
|
Guillaume
Poitevin (1630-1706) - Attribuè
à
|
Offertoire
de la Messe de Morts |
--' --" |
A1 |
| Joseph-François
Salomon (1661-1731) |
Motet
"Quis mihi dabit" |
--' --" |
A2 |
| André Campra
(1660-1744) |
Motet
"In te Domine" |
--' --" |
A3 |
|
Motet
"Quam dilecta" |
--' --" |
B1 |
|
Motet " Deus in
adjutorium" |
--' --" |
B2 |
|
|
|
| Jocelyne
Chamonin, soprano |
Raphaël
Perulli, viole da gambe |
|
| André Mallabrera, Rémy
Corazza, ténors |
Jean-Pierre Laroque,
basson |
|
| Georges
Abdoun, baryton |
Marie-Claire Alain,
orgue |
|
|
Anne-Marie
Beckensteiner, clavecin |
|
|
Chorale Stephane
Caillat / Stéphane Caillat,
Direction |
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
ottobre
1963 |
|
|
Registrazione:
live / studio |
|
studio |
|
|
Producer /
Engineer |
|
H.-A.
Durand / Daniel Madelaine |
|
|
Edizione LP |
|
Erato
- STE 50 186 - (1 lp) - durata --'
--" - (p) 196? - Analogico |
|
|
Note |
|
Image:
Cloitre de la Cathédrale
Saint-Sauveur.
|
|
|
|
|
Les
origines de
Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence
se placent à la fois
dans la légende et dans
l'histoire. Cette
cathédrale, construite
sur le tracé de òa voie
Aurèlienne,
est un trait d'union,
un relais entre le
monde romain et Louis
XIV, un Te Deum
y fut chanté pour
célèbrer la
ratification du traité
des Pyrénées et
l'accord sur la
mariage du roi avec
l'indante
Marie-Thérése
d'Espagne.
L'église
possède trois nefs
qui - de la voûte
romane aux arceaux
gothiques, puis à
l'ornamentation
Renaissance -
symbolisent le
cheminement de la
mystique. Et, dans
la grande nef
gothique, trone le
célèbre triptyque du
Buisson ardent
de Nicolas Froment,
oeuvre prestigieuse
de l'école
avignonnaise.
Sur les
portes de la
façade, les
Prophétes et les
Sibylles reçoivent
les fidéles. Le
cloitre est un
ouvrage charmant
du style
romano-provençal.
Et les chants de
la maitrise, qui a
formé le délicieux
André Campra,
semblent animer
les pierres
séculaires.
L'histoire
de la ville d'Aix
et le mervelleux
chrétien
resplendissent
dans la
cathédrale
Saint-Sauveur
d'Aix-en-Provence.
André
Bouyala
d'Arnaud
C'est en
constatant
l'éclat de
centres
musicaux tels
que la
cathédrale
Saint-Sauver
d'Aix-en-Provence,
que l'on
mesure à quel
point la
France de
l'ancien
régime était
moins
centralisée
que celle
d'aujourd'hui.
Certes, la
consécration
sur un plan
national et
international
venait encore
de Paris -
Académie
Royale, et
Concert
Spirituel, au
18° siècle -
mais
l'activité
musicale de
qualité
supérieure,
composition,
facture
d'instrumentsm
exécution,
n'était pas le
privilège de
la seule
capitale.
Aix-en-provence
est un centre
musical dès le
XI siècle. A
la mort de
René d'Anjou
(1480), et
jusqu'au 17°
siècle, la
maitrise de
Saint-Sauveur
est l'une des
plus
brillantes de
France. Au
XVII, des
maitres de
chapelle comme
Intermet,
Gantez, et
surtout
Guillaume
Poitevin (de
1667 à 1706)
sont
compositeurs,
et attirent
des élèves,
venus de toute
la zone
méridionale.
Saint-Sauveur
sera doté
d'orgues
signées Pierre
Marchand, puis
Isnard.
L'action de
Guillaume
Poitevin fut
particulièrement
féconde. Il
eut pour
disciples
d'insignes
musiciens:
Esprit
Blanchard,
Laurent
Belissen, Jean
Gilles, et
André Campra,
entre autres.
En matière de
composition
comme de
facture
d'orgues, la
Provence est
alors un actif
lieu
d'échanges
culturels
franco-italiens,
surtout sur le
plan de la
musique
religieuse. La
couleur
italianisante
des motets de
Campra
frappera les
parisiens, et
l'on verrà en
lui un
"séducteur",
par rapport à
l'art
grandiose mais
plus sévère de
Delalande.
Chez l'un ou
l'autre des
Provençaux -
et même chez
Salomon qui
n'appartient
pas à l'Ecole
d'Aix - le
style du motet
fait penser
parfois à
Ingegneri
(pour
l'expressivité
de la
polyphonie),
parfois à
Monteverdi
(pour
l'originalité
de la
déclamation et
des
enchainements
harmoniques).
L'offertoire O
Domini, d'un
Messe des
Morts anonyme,
a été
attribué, non
sans
vraisemblance,
à Guillaume
Poitevin dont
nous avons
souligné la
valeur et
l'influence.
Ecrit d'abord
en imitations,
puis en rècit
harmonisé
verticalement,
ce motet vaut
par
l'expressive
simplicité
d'un style qui
s'appuise sur
une prosodie
fort juste.
Provençal,
mais non de
formation
aixoise,
"Jean-François
Salomon aix
olse,
Jean-François
salomon
(1661-1731)
serait venu à
Paris très
Jeune.
Gambiste
célèbre, et
claveciniste
de la Reine,
il écrit non
seulement des
motets, mais
deux opéras (Médée,
créèe en 1715,
sera reprise
jusqu'en
1749). Le Quis
mihi dabit
pour 3 voix et
basse
continue,
apparait
nettement
marqué par
l'esprit
versaillais.
Les lignes
vocales sont
abondamment
ornées;
lyrique ou
dansant, d'un
bel élan
mélodique, son
style nous
achemine vers
le motet
d'allure
concertante.
André Campra
(1660-1744)
est ici
représenté par
un groupe de
trois motets,
tirés des deux
premiers des
cinq Livres
que publia
Ballard, à
Paris, autour
de 1700. L'In
Te Domine,
à trois voix
et basse
continue est
remarquable
par sa
"doucer"
harmonique;
mais le verset
Respice
vota
montre que
Campra est
capable de
retrouver la
force
expressive de
l'ancien motet
italien. La
même formule,
3 voix et
basse, préside
au Quam
Dilecta,
moins vaste et
moins
concertant que
celui de
Rameau, mais
caractérisé
par son
aisance
mélodique, et
la fluidité de
son harmonie.
On retrouvera
un ton
exceptionnellement
lyrique dans
le quatrième
verset du
motet Deus
in adjutorium
(psaume 69),
véritable
arioso
dramatique.
Dans tous ces
"petits
motets" (à
effectifs
réduits), la
diversité de
plans est
ménagée par
l'alternance
des solistes
(un, deux ou
trois), et du
"petit
choeur".
Peut-étre
est-ce ici le
lieu de
rappeler que
la musique
française
classique
avait pour
premier idéal
d'étre
uneillustration
sonore de la
Parole, de
donner un
retentissement
coloré à
l'accentuation
naturelle et à
la
signification
du discours
verbal. Cette
musique n'est
que
secondairement
une
"construction
en sol": les
formes fixes,
par exemple,
en sont
absentes (en
dehors des
morceaux
chrégraphiques);
ce qui ne veut
pas dire
qu'elle ne
regulert pas
une grande
habilité. au
contraire, le
musicien se
tient
constamment
das un
assujettissement
volontaire au
texte:
attitude qui,
si elle lui
fournit des
idées d'ordre
symbolique,
descriptif, ou
expressif, le
retient de
concevoir une
oeuvre sur un
plan
uniquement et
exclusivement
musical. Les
violonistes
italiens et
les organistes
allemands sont
évidemment aux
antipodes
d'une telle
manière
d'utiliser la
musique. En
somme,
l'auditeur qui
n'attacherait
pas une
importance
extreme an
texte -
français ou
latin - du
motet, ou de
l'opéra
français
classique,
méconnaitrait
une part
essentielle de
la
signification
de cette
musique. a
notre avis, il
y a pas
d'autre raison
à l'oubli dans
lequel était
tombé ce
réportoire: à
la fin du
XVIII siècle,
le français a
vu décliner
son statut de
langue
internationale,
et le latin a
subi les mêmes
vicissitudes,
en France
même, que la
religion
catholique.
Les
Provençaux,
quand ils
"montèrent" à
Paris et à
Versailles,
apparurent
"italiens",
dans la mesure
même où ils se
montralent
moins sournis,
en musique, à
la primauté de
l'éloquence
verbale
chantée.
Olivier
Alain
|
|